
Publication, dans le numéro janvier-février de la revue Esprit, d’une recension consacrée au dernier roman de Nicolasz Rey, Crédit illimité.
À retrouver ici : https://esprit.presse.fr/actualite-des-livres/matteo-scognamiglio/credit-illimite-de-nicolas-rey-44478
Une version longue est disponible plus loin dans cet article.
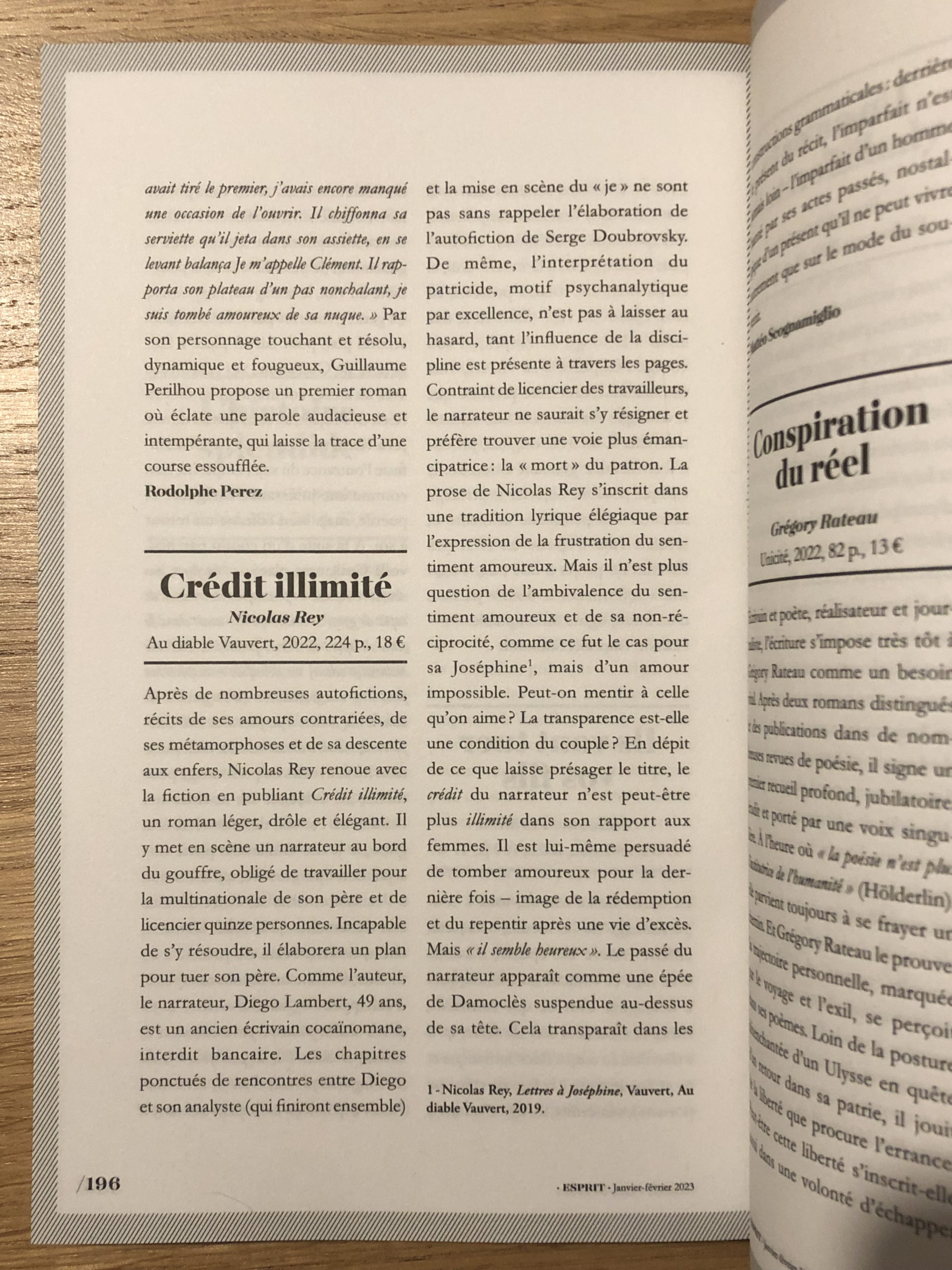
Crédit illimité, de Nicolas Rey. Au Diable Vauvert, 224 pages, 18 €.
Après de nombreuses autofictions, récits de ses amours contrariées, de ses métamorphoses et de sa descente aux enfers, Nicolas Rey renoue avec la fiction en publiant Crédit Illimité, un roman léger, drôle et élégant. Il y met en scène un narrateur au bord du gouffre, obligé de travailler pour la multinationale de son père et de licencier quinze personnes. Incapable de s’y résoudre, il élaborera un plan pour le tuer.
Le retour à la fiction du lauréat du Prix de Flore 2000 n’est toutefois pas dépourvu d’aspects autobiographiques. Le narrateur, Diego Lambert, en est l’exemple : quarante-neuf ans, ancien écrivain et cocaïnomane, interdit bancaire… Ces considérations, loin de toute dérive sainte-beuviste, éclairent notre rapport analytique à l’œuvre, et notamment à son jeu des « je ». Le choix de l’auteur de placer son texte sous les auspices de la psychanalyse nous conforte dans cette idée. En effet, les chapitres ponctués de rencontres entre Diego et son analyste (qui finiront ensemble) et la mise en scène du « je » ne sont pas sans nous rappeler l’élaboration de l’autofiction doubrovskienne[1]. Comme l’évoque à juste titre Philippe Gasparini, la fictionnalisation de la cure « donne au lecteur l’impression, ou plutôt l’illusion, d’entrer en contact avec l’inconscient du personnage. »[2] Dans Crédit illimité, les séances de psychanalyse s’inscrivent dans une narration de la confession, de la mise à nue, du dévoilement. L’effet recherché est double : nous y retrouvons d’une part un enjeu narratif évident ; et d’autre part un enjeu métalittéraire (l’éviction d’une zone grise qui rend la distinction entre auteur et narrateur difficile, s’inscrivant alors dans le jeu des « je »). De la même façon, l’interprétation du patricide, motif Œdipien et psychanalytique par excellence, n’est pas à laisser au hasard ici tant l’influence de la discipline est présente à travers les pages. D’un point de vue symbolique : tuer le père, c’est s’émanciper de sa tutelle, construire son identité propre loin de toute influence. Et cette notion d’émancipation s’interprète également du point de vue de la lutte sociale. Contrait de licencier des travailleurs, le narrateur ne saurait s’y résigner et préfère trouver une autre voie, plus émancipatrice : la ‘mort’ du patron. Figure tutélaire, autoritaire, accaparatrice, paternisante, elle se dresse comme un obstacle à l’épanouissement du travailleur. Il n’est d’ailleurs pas anodin que dans le roman de Nicolas Rey ces deux figures d’autorité (le père et le patron) se retrouvent en un seul personnage.
Bien évidemment, la prose de Nicolas Rey s’inscrit toujours dans une tradition lyrique élégiaque, dans l’expression de la frustration du sentiment amoureux. Un élément vient cependant bouleverser notre horizon d’attente[3] : il n’est plus ici question de l’ambivalence du sentiment amoureux et de sa non-réciprocité, comme ce fut le cas pour sa Joséphine[4], mais d’un amour impossible. À nouveau, la question de la morale intervient. Peut-on mentir à celle que l’on aime ? Le désir de transparence est-il une condition sine qua non à la réalisation effective du couple ? En s’éprenant de son analyste, le narrateur entre malgré lui dans le schéma de l’amour impossible. Mais la voix de Nicolas Rey se veut au-delà des jugements moraux, et cherche au contraire à les transcender. En dépit de ce que laisse présager le titre, le crédit du narrateur n’est peut-être plus illimité dans son rapport aux femmes. Il est lui-même persuadé de tomber amoureux pour la dernière fois. Le dernier amour s’érige en image de la rédemption, du repentir après une vie d’excès. Mais une des dernières phrases vient bouleverser très subtilement l’idylle : « il semble heureux ». Sembler n’est pas être et nous comprenons que le bonheur est peut-être éphémère. Les nombreuses références à la vie antérieure du narrateur en attestent : son passé apparaît comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Cela transparaît dans les constructions grammaticales : le narrateur raconte au présent mais son tableau se veut déjà comme un souvenir. Derrière ce présent, l’imparfait n’est jamais loin. Il guette sans jamais se montrer. Mais il ne s’agit toutefois pas de l’imparfait d’une relation sur le déclin, aux confins de la rupture. C’est l’imparfait d’un homme hanté par ses actes, nostalgique d’un présent qu’il ne peut vivre autrement que sur le mode du souvenir.
[1] Fils, Serge Doubrovsky, Éditions Galilée, 1977.
[2] Est-il je? roman autobiographique et autofiction, Seuil, 2004, 400 p.
[3] Pour une esthétique de la réception, Hans Robert Jauss, 1972
L’Acte de lecture. Théorie de l’effet esthétique, Iser W., 1976. (trad 1985).
[4] Lettres à Joséphine, Au Diable Vauvert, 2019
Dos au mur, Au Diable Vauvert, 2018
La marge d’erreur, Au Diable Vauvert, 2021