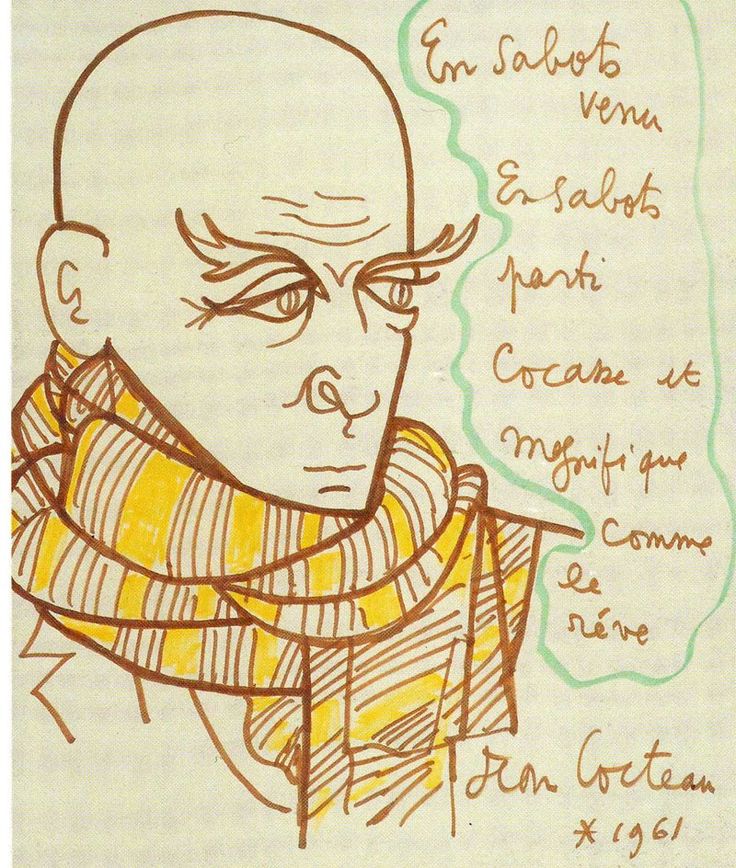Il fut l’une des figures majeures de la bohème montmartroise et un grand ami de Picasso et Apollinaire. Pourtant, son nom n’a aujourd’hui d’écho que dans l’esprit de rares inconditionnels. Poète et peintre, Juif converti au catholicisme, homosexuel noceur en lutte contre ses addictions, Max Jacob était un homme aux multiples visages, insaisissable et en perpétuelle métamorphose. Il était un docteur Jekyll des Années folles tourmenté par son M. Hyde. C’est peut-être par cette contradiction inhérente à sa personne que l’on peut expliquer sa postérité en demi-teinte. Il incarne toutefois l’élégance et l’âge d’or de la poésie française de la première moitié du XXe siècle. Bref retour désordonné sur son Œuvre.
Une Œuvre exigeante et singulière, aux prises entre les esthétiques classique et baroque
Comme l’a très justement rappelé Claude Tuduri dans le quatre-centième numéro de la revue Études, Max Jacob est un écrivain qui « dérange les attentes traditionnelles du lecteur et exige de lui la participation active à la création d’un univers énigmatique et bigarré ».
Si la publication des Conseils à un jeune poète semble consacrer un certain plaidoyer pour une esthétique classique, un grand nombre de constructions stylistiques dévoilent une appétence du poète pour le baroque : « Adieu, barreaux, nous partons vers le Nil ; / Nous profitons d’un Sultan en voyage / Et des villas bâties avec du fil / L’orange et le citron tapisseraient la trame / Et les galériens ont des turbans au front » (« La Rue Ravignan », Le Laboratoire central, p. 141). Ici, le renoncement à la mise en place d’un récit linéaire ou l’ébranlement de la concordance des temps sont autant d’éléments qui s’inscrivent dans une démarche émancipatrice vis-à-vis du carcan classique.
Plus largement, l’écriture jacobienne emprunte énormément aux motifs baroques : inclination pour la métamorphose et le masque, pour les frontières brouillées, la dissymétrie, les reflets et les jeux avec les codes littéraires. En ce sens, les titres de ses ouvrages sont très révélateurs : L’homme de chair et l’homme de reflet (Le Sagittaire, 1924) ; L’Homme de cristal (Gallimard, 1967).
De cette ambivalence se dégage une volonté de déconstruction du monde poétique. Il se positionne de façon permanente dans un entre-deux. Ses textes produisent un effet d’inachèvement et de mouvance perpétuelle, le tout ponctué de marques d’oralité et d’impromptus qui se distinguent des codes traditionnels du langage poétique. À nouveau, les titres de ses recueils sont révélateurs de son entreprise : Le Cornet à dés ; Le Laboratoire central.
Max Jacob comme « symbiose des identités paradoxales » (Catherine Fhima) : le rôle de la foi.
Nous ne pouvons toutefois résumer le projet jacobien au seul désir de déconstruction du monde poétique. En 1909, un matin d’octobre[1]En septembre, selon les versions., sa vie prend un tournant radical. L’apparition christique, sur l’un des murs de sa chambre à Montmartre, marque le point de départ d’une nouvelle vie pour le poète. Juif de naissance, il se convertit au christianisme six années plus tard, à la suite de cet épisode. Épisode qui entraîne un tel bouleversement dans la vie de Jacob qu’il ne cesse de le ressasser et de chercher à y donner un sens, ce qui entraîne de nombreuses répercussions d’un point de vue textuel. En parallèle de ce que cette conversion implique d’un point de vue de style de vie, il y voit aussi en un sens les prémices d’une nouvelle esthétique. Dans le récit postérieur[2]Max Jacob, « Récit sur ma converstion », in La Défense de Tartufe, extases, remords, visions, prières, poèmes et méditations d’un Juif converti, commenté et annoté par André … Continue reading qu’il fait de sa conversion à la demande d’un ecclésiastique, il s’exprime en ces termes :
« Après une journée de paisible travail à la Bibliothèque nationale, rue Richelieu à Paris, je rentrais chez moi […]. Après avoir enlevé mon chapeau, je m’apprêtais, en bon bourgeois, à mettre mes pantoufles quand je poussai un cri. Il y avait sur mon mur un Hôte. Je tombai à genoux, mes yeux s’emplirent de larmes soudaines. Un ineffable bien-être descendit sur moi, je restai immobile, sans comprendre. […] Il me semble que tout m’était révélé. […] deux mots seulement m’emplissaient : MOURIR, NAÎTRE. […] il était vêtu d’une longue robe de soie jaune clair, ornée de parements bleu clair. Je le vis d’abord de dos, sa belle chevelure tombait sur ses nobles épaules. […] La campagne dans laquelle il se trouvait était un paysage très agrandi que j’avais dessiné quelques mois auparavant et qui représentait le bord d’un canal. […] »
Il n’est pas anodin de le voir évoquer l’idée d’une renaissance, intensifiée ici par le recours aux lettres capitales : « MOURIR, NAÎTRE. » D’une certaine façon, le poète expérimente, lui aussi, une résurrection. Il pousse un cri à l’instar du nourrisson sortant du ventre de sa mère et ne connaît plus que deux mots tel l’enfant apprenant à parler.
Dès lors, son écriture s’inscrit dans une volonté de témoigner de l’apparition d’une miséricorde divine dans la vie des hommes : « Vagabond d’un paysage à l’autre, d’un objet à l’autre. O mes yeux vagabonds ! / peut-on vous appeler vagabonds, puisque vous n’avez vu que Dieu, ô mon Dieu fixe, compagnon, tu n’as qu’un compagnon. Voyageur, tu es immobile comme l’aiguille de la boussole. » (« J’ai soif, Invention III », Actualités éternelles)